
Il y a cent ans naissait la journaliste, autrice, universitaire et militante révolutionnaire sud-africaine Ruth First. Elle sera assassinée le 17 août 1982 à Maputo par le régime d’apartheid dans un attentat à la lettre piégée. Plus de quatre décennies après sa disparition, que reste-t-il de son héritage ? Dans la biographie consacrée à Ruth First et à son mari Joe Slovo (Ruth First and Joe Slovo in the War Against Apartheid, 2013), l’historien Alan Wieder avait constaté, lors d’un déplacement en Afrique du Sud : « Paradoxalement, lorsque vous parlez avec les gens en Afrique du Sud aujourd’hui, peu de personnes adultes, d’adolescents ou d’enfants connaissent la contribution significative de Ruth ou de Joe dans la lutte contre l’apartheid. » Pourtant, perpétuer la mémoire de Ruth First permet de se souvenir des combats d’une militante qui, face aux incessantes persécutions du régime d’apartheid, a fait le serment de ne jamais abdiquer.
Ruth Heloise First naît le 4 mai 1925 à Johannesburg, dans une famille juive originaire d’Europe orientale. Son père, Julius First, arrive en Afrique du Sud en 1907, à l’âge de 10 ans, en provenance de Lettonie, tandis que la mère de Ruth, Tilly Matilda Leveton, originaire de Lituanie, avait immigré en 1904, alors qu’elle n’avait que 3 ans.
Comme des dizaines de milliers de Juifs ayant immigré en Afrique du Sud à la fin du XIXe siècle, les parents de Ruth First ont fui les pogroms qui s’étaient intensifiés en Europe orientale à la suite de l’assassinat du tsar Alexandre II, en 1881 : à la mort de ce dernier, jugés responsables du régicide, les Juifs subissent une longue campagne de persécution qui se traduit notamment par l’expulsion de leurs terres et l’interdiction d’exercer certaines professions. Une situation qui, selon l’historien Alan Weider1, « préfigure, ironiquement, le sort que connaîtront les Noirs en Afrique du Sud ».
« Tempête antisémite »
Ainsi, entre 1880 et 1910, près de 40 000 Juifs, pour la plupart originaires d’Europe de l’Est, immigrent en Afrique du Sud2. Cette immigration se concentre dans la ville de Johannesburg, devenue le centre d’une importante activité minière à partir de 1886. En 1892, Johannesburg est la ville la plus peuplée en Afrique subsaharienne. Selon Alan Wieder, à la veille de la Première Guerre mondiale, sur les 200 000 habitants que comptait Johannesburg, 25 000 étaient juifs.
L’intensification de l’immigration juive en provenance d’Europe de l’Est déclenche une véritable « tempête antisémite3 » dans une Afrique du Sud où la minorité blanche impose un règne tyrannique à la majorité noire.
En 1930, le Parlement sud-africain adopte la loi dite « des quotas » (« Quota Act »), dont le but est de limiter l’immigration en provenance de plusieurs pays d’Europe de l’Est, en particulier la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Russie. S’ils ne sont pas explicitement mentionnés dans la loi imposant des quotas d’immigration en fonction des pays d’origine, les Juifs d’Europe orientale, jugés « non digérables » ou encore « non absorbables », sont directement visés. Voici comment Daniel François Malan4, l’un des architectes du régime d’apartheid – il assumera la fonction de Premier ministre de 1948 à 1954 –, à l’époque député du Parti national, justifiait la loi sur les quotas de 1930 :
Je dirais que le premier principe est le désir qu’éprouve toute nation de préserver son développement sur la base de sa « composition originale ». Par conséquent, nos lois sur l’immigration ne pouvaient exclure des pays comme la Hollande, la France, le Commonwealth Britannique, ou encore l’Allemagne. Le second principe auquel je dois me référer est celui de l’« inassimilabilité ». […] Chaque nation considère, à tous points de vue, que c’est une faiblesse, dans le corps de cette nation, qu’il existe une minorité non digérée, non absorbée et non absorbable, car cela conduit toujours à toutes sortes de difficultés.
Cette rhétorique antijuive ne fera que s’intensifier au cours des années suivantes, devenant plus directe et plus explicite, à mesure que la « question juive » se déplaçait au cœur de la vie politique sud-africaine. Ainsi, en mai 1938, lors d’un débat parlementaire, Paul Sauer, alors député du Parti national (qui allait mettre en place les lois d’apartheid à partir de 1948), exprimait5 son opposition à l’immigration juive dans des termes désormais débarrassés des précautions langagières ayant caractérisé l’adoption de la loi dite « des quotas » quelques années plus tôt : « En ce qui concerne les Juifs, proclamait Sauer, le Parti national est opposé à toute nouvelle immigration car il y a déjà trop de Juifs dans le pays. Une autre raison est que le Juif est inassimilable et reste toujours un Juif. Il ne devient jamais un véritable citoyen du pays comme les membres d’autres nations. Une autre raison est que lorsqu’un Juif vient en Afrique du Sud, il entre en peu de temps dans le commerce ou dans l’une des professions libérales et la norme éthique du commerce ou de la profession est aussitôt abaissée ou sapée. Les Juifs enlèvent le travail des mains de notre propre peuple et le pain de leur bouche. Notre mission est de défendre notre peuple avant tout. »
« Le problème des Blancs pauvres »
Dans la presse, la littérature ou encore les discours politiques, les Juifs sont décrits comme une menace pour l’équilibre de la société sud-africaine (blanche). L’image des Juifs dans la culture populaire est ainsi associée aux « Péruviens » (trafiquants d’alcool vivant dans des conditions insalubres et réfractaires aux « bonnes manières » de la société blanche « civilisée »), aux Hoggenheimer (opérateurs financiers dont les activités spéculatives étaient considérées comme la principale cause de l’appauvrissement des agriculteurs afrikaners) ou encore aux « judéo-bolchéviques », accusés d’endoctriner les travailleurs noirs et de les inciter à la rébellion contre la minorité blanche.
En 1932, un rapport produit par la fondation de la multinationale états-unienne Carnegie et consacré à l’analyse des causes de la pauvreté chez les Blancs sud-africains, en particulier chez les Afrikaners, se fait l’écho de l’antisémitisme ambiant au sein de la minorité blanche dans l’Afrique du Sud de l’entre-deux-guerres. Comme le souligne l’historien Milton Shain dans A Perfect Storm. Antisemitism in South Africa (2015), la commission en charge de l’étude sur « le problème des Blancs pauvres » (« The Poor White Problem6 ») « entendait régulièrement dire que les Juifs, par leur ruse, étaient à l’origine de la situation difficile des Afrikaners. L’un des commissaires – Johannes Grosskopf, de l’université de Stellenbosch, dont le rapport constitue l’un des cinq volumes publiés sur la question des “Blancs pauvres” – conclut également que “les transactions commerciales juives causent de graves préjudices. Des personnes calmes et sensées de toutes les régions du pays l’ont confirmé à maintes reprises.” »
Symbole de l’antisémitisme qui s’exprime alors ouvertement au sein de la société sud-africaine, Ossewabrandwag (littéralement « sentinelle du char à bœuf » en afrikaans), une organisation ouvertement pronazie fondée en 1938, parvient à rassembler des centaines de milliers de membres7. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs cadres de l’Ossewabrandwag, pourtant internés pendant la guerre en raison de leur militantisme pronazi, deviendront des hommes politiques de premier plan sous le régime d’apartheid, à l’image de John Vorster, ministre de la Justice de 1961 à 1966, puis Premier ministre de 1966 à 1978.
Ruth First et Joe Slovo, unis par le Parti communiste
Ruth First grandit ainsi dans une société raciste, gangrénée par l’antisémitisme et déterminée à contenir la « subversion rouge » que Ruth incarnera quelques décennies plus tard dans le sillage de ses parents. En 1921, les parents de Ruth, Julius et Tilly, prennent part à la fondation du Parti communiste d’Afrique du Sud, dont ils dirigent la section de Johannesburg.
À l’université de Witwatersrand, Ruth intègre la Ligue des jeunes communistes et devient cofondatrice de la Fédération des étudiants progressistes. Au sein de cette organisation étudiante radicale, Ruth milite aux côtés d’Ismael Meer, Joe Slovo mais aussi de futurs cadres du Congrès national africain (African National Congress, ANC) tels que Nelson Mandela ou encore Oliver Tambo. En 1946, alors qu’elle n’a que 21 ans, Ruth manifeste aux côtés de 74 000 mineurs noirs lors d’un important mouvement de grève pour protester contre leurs conditions de travail et réclamer de meilleurs salaires. L’année 1946 marque également le début de sa carrière journalistique et son adhésion au Parti communiste d’Afrique du Sud.

En 1949, Ruth First épouse Joe Slovo (né en Lituanie en 1926), également membre du Parti communiste et futur dirigeant de la branche armée de l’ANC, Umkhonto we Sizwe (la « Lance de la Nation », en zoulou). De cette union naissent trois enfants : Shawn, Gillian et Robyn.
117 jours de prison et un livre
En tant que militante politique, Ruth prend part à la fondation du Congrès des démocrates sud-africains (allié de l’ANC) en 1953 et participe en 1955 à la rédaction de la Charte de la liberté, texte fondamental dans la lutte contre le régime d’apartheid adopté lors d’un congrès du peuple réunissant des délégués de tout le pays.
Comme journaliste, de 1946 à 1963, Ruth First ne cesse de documenter et de dénoncer les conditions de vie et de travail vécues par les Noirs. Elle participe à plusieurs mobilisations contre les lois discriminatoires imposées par le régime d’apartheid à la majorité noire. Ruth signe des dizaines d’articles pour plusieurs journaux (The Guardian, People’s World, Advance, New Age, Spark, Fighting Talk...) qui seront tour à tour interdits par le régime d’apartheid.

Mais ces campagnes de censure ne suffisent pas à venir à bout de la détermination de la militante qui concevait le journalisme comme un instrument au service du combat pour la libération des masses opprimées. En juin 1962, alors que Fighting Talk, le journal dont elle est la rédactrice en chef, est menacé d’interdiction, Ruth First rédige un éditorial intitulé « Notre devoir, tel que nous le concevons » (« Our duty, as we see it »), dans lequel elle rappelle le sens de son combat et réaffirme sa détermination à se battre jusqu’au bout :
Nous nous sommes engagés dans la campagne contre le nazisme sud-africain et nous continuerons à le faire aussi longtemps que possible. Nous avons fait campagne contre le représentant local du nazisme, le Parti national. Nous continuerons à le faire. Nous avons lutté pour la nouvelle Afrique du Sud dont les contours sont dessinés dans la Charte de la liberté. Nous continuerons à le faire. Nous avons œuvré pour l’unité de tous les démocrates sud-africains et de tous les épris de la liberté, pour la cause commune de la destitution du gouvernement actuel et de l’ouverture de la voie vers la démocratie pour tous. Nous continuerons à le faire.
En réponse au militantisme de Ruth First, le régime d’apartheid intensifie la répression à son encontre. En 1956, elle est jugée avec 155 autres prévenus pour « haute trahison ». Acquittée, elle est néanmoins incarcérée sept ans plus tard, en 1963, dans le cadre de la loi dite « des 90 jours ». En vertu de celle-ci, toute personne soupçonnée de vouloir intenter à la sûreté de l’État pouvait être détenue de manière « préventive », sans procès, pour une durée de 90 jours. Ruth passe finalement 117 jours dans un confinement strict et à l’isolement. Elle raconte son expérience carcérale dans un livre intitulé 117 jours, publié à Londres en 1965.
« Privilège blanc » et « politique révolutionnaire »
Ruth y décrit en détail les mécanismes de torture psychologique utilisés par le régime d’apartheid, l’instrumentalisation de la religion pour justifier la domination blanche (la Bible étant le seul livre autorisé en prison), mais aussi le traitement inhumain que les gardiennes (blanches) de la prison réservaient aux femmes noires. En témoigne ce passage saisissant du livre :« Elles appelaient les femmes africaines “serpents noirs, filles kaffir [insulte raciste à l’encontre des Noirs, NDLR], prostituées noires, singes, et ordures noires”, comme si ces injures les confortaient dans leur sentiment de supériorité par rapport à des êtres jugés inférieurs et délinquants. »
La détention est également l’occasion pour la journaliste et militante politique de méditer sur le rôle des militants blancs dans la lutte contre le régime raciste et suprémaciste d’apartheid. Ruth écrit dans son livre :
Nous, les Blancs qui nous sommes engagés dans la politique de contestation aux côtés des Africains, des Indiens et des “personnes de couleur” [terme désignant les personnes métisses depuis la colonisation britannique, NDLR], menions une vie vigoureusement provocatrice. Nos consciences étaient saines dans une société accablée par la culpabilité. Pourtant, au fur et à mesure, notre petit groupe menait une existence de plus en plus schizophrénique. Il y avait la belle vie que nous garantissait le privilège blanc et, simultanément, une absorption complète dans une politique révolutionnaire et la défiance des valeurs de notre propre groupe racial. À mesure que la lutte s’intensifiait, les privilèges conférés par l’appartenance au groupe des Blancs étaient éclipsés par le prix qu’on nous faisait payer pour notre participation politique.
Malgré les pressions et les menaces exercées (y compris sur ses enfants) par ses geôliers, Ruth refuse de livrer ses complices. Sous le poids de la torture psychologique subie en détention, Ruth First tente de mettre fin à ses jours.
Quelques mois après sa libération, elle prend le chemin de l’exil. Le 14 mars 1964, elle quitte son pays natal avec deux de ses filles, Gillian et Robyn, en direction de Londres, où elles rejoindront Joe Slovo (exilé depuis 1963), Shawn, leur fille aînée, ainsi que les parents de Ruth.
Démanteler le mythe de « la mission civilisationnelle »
En exil, Ruth poursuit son combat contre l’apartheid en s’appuyant sur une arme particulièrement redoutable : sa plume. Dans plusieurs ouvrages publiés à partir du milieu des années 1960, Ruth First expose la responsabilité accablante des puissances occidentales dans le maintien et la perpétuation de la suprématie blanche et du colonialisme en Afrique australe (Afrique du Sud, Afrique du Sud-Ouest, Rhodésie) mais aussi dans les colonies portugaises, où de longues et sanglantes guerres de libération déboucheront sur les indépendances de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, de l’Angola et du Mozambique.
Dans La Connexion sud-africaine (The South African Connection), ouvrage au sous-titre évocateur (« Les investissements occidentaux dans l’apartheid ») publié en 1972, Ruth First, Jonathan Steele et Christabel Gurney décrivent avec minutie la complicité des firmes multinationales et des États occidentaux, ainsi que du Japon, dans la consolidation de l’apartheid sud-africain.
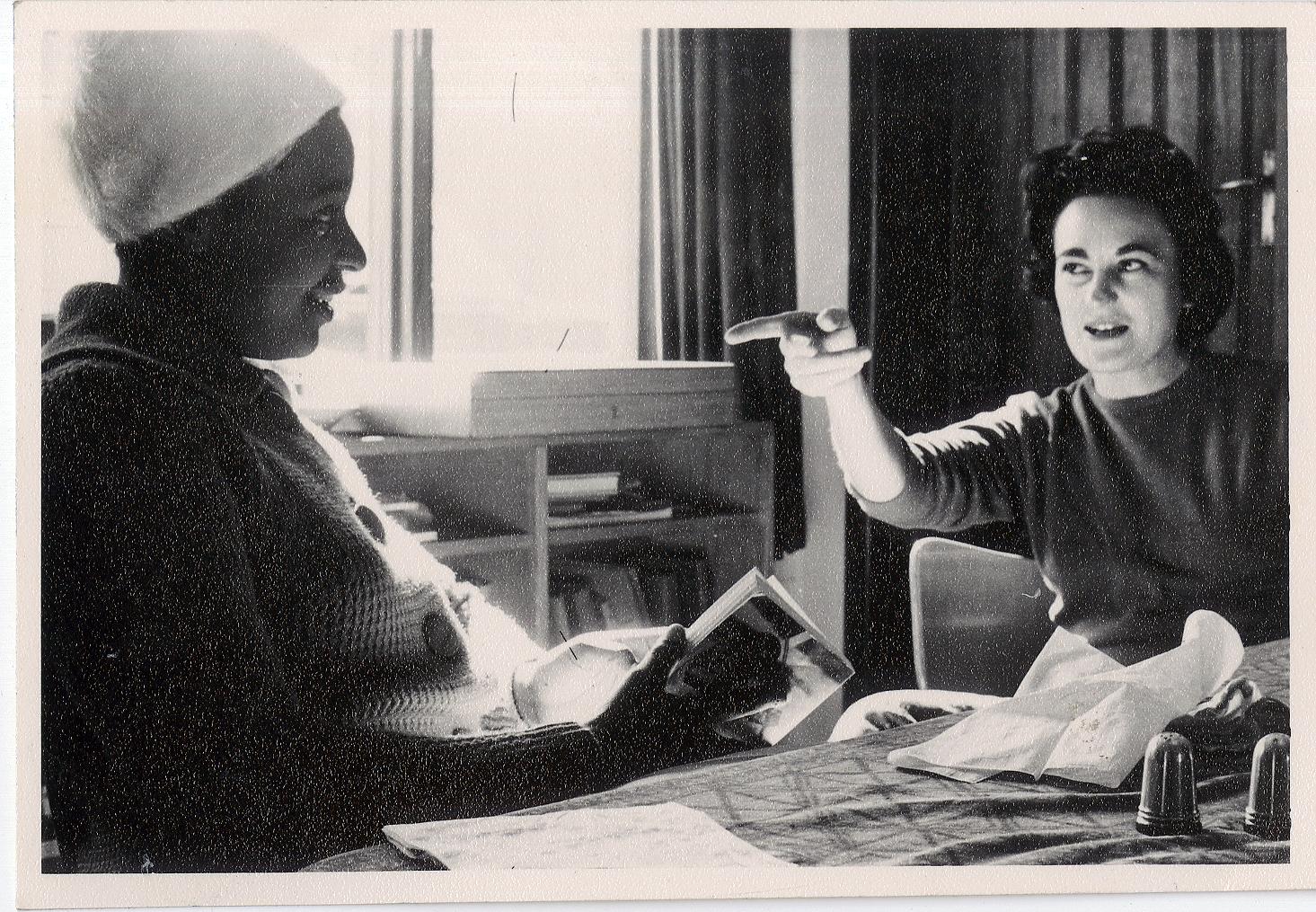
Dans Les Guerres du Portugal en Afrique (Portugal’s Wars in Africa), livret d’une trentaine de pages à vocation pédagogique publié en 1971 par le Fonds international de défense et d’aide de l’Afrique australe (International Defence Aid Fund ou IDAF, en anglais), Ruth First bat en brèche, de manière méthodique, la propagande coloniale sur les prétendus bienfaits de la « mission civilisatrice » européenne : « Ce que le colonialisme portugais n’a pas apporté à ses sujets africains au cours des siècles, le PAIGC [Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, NDLR] les a aidés à le construire eux-mêmes en moins d’une décennie. Deux ans seulement après le début de la guerre de libération, le PAIGC a publié des directives pour la création d’écoles et la diffusion de l’éducation dans toutes les régions libérées. […] Chaque année, les effectifs augmentent. Comme pour l’éducation, les services de santé mis en place par le PAIGC en l’espace de quelques années sont supérieurs à tout ce qui avait été fait pendant la période coloniale. »
Contributrice à la pensée de Nelson Mandela
Selon l’historien Gerald Horne8, Ruth First a contribué à façonner la trajectoire idéologique et politique de Nelson Mandela. En effet, d’après Horne, l’expérience de Mandela « avec des personnes comme Ruth First l’a aidé à se défaire de son anticommunisme initial ». C’est donc en toute logique que Ruth First rédige, en 1965, la préface de No Easy Walk to Freedom, recueil d’articles et de discours de Nelson Mandela. C’est l’occasion pour la militante, désormais en exil, de rendre un vibrant hommage à son camarade de lutte qui purgeait alors une longue peine de prison à Robben Island :
Le prisonnier politique est la victime la plus maltraitée d’un ordre qui nourrit un mépris insensible pour la souffrance humaine. Mais il est aussi le révolutionnaire assiégé, qui se bat sur son propre champ de bataille, si nécessaire par la grève de la faim, et il y en a eu plusieurs sur l’île, même si la presse mondiale n’en a pas fait état. Chaque prisonnier sait que sa peine n’est pas la fin du combat mais un nouveau départ dans un monde où chaque rencontre avec un gardien est une nouvelle confrontation avec l’ordre oppressif et où l’autorité, armée de règlements grotesques, de mitrailleuses et de clôtures électrifiées, tremble devant la résistance, l’optimisme et la capacité de combat des hommes qu’elle a mis en cage. Mandela, murmure-t-on à travers les murs de la prison, est un prisonnier politique aussi magnétique qu’il a été un orateur de masse et un commandant politique clandestin, et il continue à faire rayonner la confiance, la force et l’autorité morale qui ont soutenu la lutte pour la liberté en Afrique dans ses jours les plus difficiles, et qui, avec le temps, feront s’écrouler le système de l’apartheid.
L’année précédente, Ruth First avait préfacé La Révolte des paysans (The Peasants’ Revolt), ouvrage de Govan Mbeki, un autre leader de la lutte contre l’apartheid également emprisonné à Robben Island. Au cours de son exil londonien, Ruth First rédige plusieurs autres ouvrages, dont Le Canon d’un fusil (The Barrel of a Gun), publié en 1970. Il s’agit sans nul doute du plus célèbre. Dans ce livre, Ruth se propose d’analyser « l’intervention des armées en politique » dans un contexte postindépendance marqué par plusieurs dizaines de coups d’État en Afrique.

Esprit libre, Ruth First n’hésite pas à manifester ses désaccords avec la ligne officielle du Parti communiste sud-africain, ce qui lui vaut des remontrances, voire des menaces d’expulsion de la part de ses camarades. Elle dénonce ainsi les interventions de l’Armée rouge en Hongrie en 1956 et en Tchécoslovaquie en 1968 et soutient l’Érythrée dans sa guerre d’indépendance contre l’Éthiopie.
Une œuvre plus « solide que les bombes »
En 1972, Ruth décroche un poste de chercheuse à l’université de Manchester et, en 1974, elle devient professeure à l’université de Durham. Toutefois, le massacre de Soweto, en 1976, finit de la convaincre que son soutien à la lutte contre l’apartheid doit se faire en Afrique, au plus près de celles et ceux qui combattent le régime. Elle retourne en Afrique australe en 1977, à Maputo, capitale du Mozambique nouvellement indépendant, où elle est nommée directrice du Centre d’études africaines (CEA) de l’université Eduardo Mondlane. En tant que directrice du CEA, elle encourage les étudiants et les chercheurs à confronter leur travail théorique aux réalités du terrain, dans un pays dévasté par plusieurs siècles de colonisation.
Le 17 août 1982, au lendemain d’une conférence internationale de l’Unesco organisée à Maputo, Ruth First trouve la mort après avoir ouvert une lettre piégée envoyée par les tueurs à gages du régime d’apartheid. Elle est assassinée sur ordre de Craig Williamson, un officier de la police sud-africaine (South African Police, SAP).
Six jours plus tard, son mari, Joe Slovo, ses enfants Shawn, Gillian et Robyn, sa mère Tilly, et plus de 3 000 autres personnes, assistent à ses funérailles au cimetière de Llanguene à Maputo. À cette occasion, Albie Sachs, militant anti-apartheid qui, comme Ruth First, avait fait le choix de venir s’installer au Mozambique en 1977, devenant professeur de droit à l’université Eduardo Mondlane après un exil de dix ans à Londres, prononce un discours mémorable en hommage à sa défunte amie, camarade de lutte et collègue. Saluant la mémoire de celle qui a « utilisé tous les avantages dont disposent les Blancs pour alimenter la lutte en faveur de l’émancipation en détruisant les barrières entre les Noirs et les Blancs9 », Albie Sachs décrit la personnalité de Ruth First comme le fruit de trois contradictions : « (1) Être une personne blanche dans un mouvement noir ; (2) appartenir à la classe moyenne dans un mouvement ouvrier ; et (3) être une femme dans un environnement politique masculin. »
Également présent lors des funérailles, Marcelino dos Santos, vice-président du Mozambique et représentant du Front de libération du Mozambique (Frelimo, le parti au pouvoir jusqu’à aujourd’hui), s’incline devant la tombe de son amie Ruth, « une combattante sud-africaine de la liberté qui renforçait l’unité entre les peuples mozambicain et sud-africain ». De son côté, Moses Mabhida, président du Parti communiste sud-africain, rappelle que « Ruth s’est battue pour l’unité inébranlable de la théorie révolutionnaire et de la pratique révolutionnaire. Elle a laissé derrière elle une œuvre solide que des bombes, quelle que soit leur quantité, ne pourraient détruire. »
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).
 Faire un don
Faire un don
Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.
1Alan Wieder, Ruth First and Joe Slovo in the War Against Apartheid, NYU Press, Monthly Review Press, 2013.
2Gedeon Shimoni, Jews and Zionism : The South African Experience, Oxford University Press South Africa, 1980.
3L’expression « tempête antisémite » fait référence au titre d’un ouvrage de l’historien Milton Shain consacré à la question de l’antisémitisme en Afrique du Sud dans l’entre-deux-guerres et intitulé A Perfect Storm : Antisemitism in South Africa 1930–1948, Jonathan Ball, 2015.
4Milton Shain, The Roots of Antisemitism in South Africa, University of Virginia Press, 1994.
5Milton Shain, A Perfect Storm. Antisemitism in South Africa (1930-1948), Johnathan Ball, 2015.
6Sur ce point, lire également Tiffany Willoughby-Herard, Waste of a White Skin.The Carnegie Corporation and the Racial Logic of White Vulnerability, University of California Press, 2015.
7Christopher Marx, Oxwagon Sentinel : Radical Afrikaner Nationalism and the History of the Ossewabrandwag, University of South Africa Press, 2008.
8Gerald Horne, White Supremacy Confronted : U.S. Imperialism and Anti-Communism vs. the Liberation of Southern Africa from Rhodes to Mandela, International Publishers, 2019.
9Alan Wieder, Ruth First and Joe Slovo in the War Against Apartheid, Monthly Review Press, 2013.
10Alan Wieder, Ruth First and Joe Slovo in the War Against Apartheid, NYU Press, Monthly Review Press, 2013.
11Gedeon Shimoni, Jews and Zionism : The South African Experience, Oxford University Press South Africa, 1980.
12L’expression « tempête antisémite » fait référence au titre d’un ouvrage de l’historien Milton Shain consacré à la question de l’antisémitisme en Afrique du Sud dans l’entre-deux-guerres et intitulé A Perfect Storm : Antisemitism in South Africa 1930–1948, Jonathan Ball, 2015.
13Milton Shain, The Roots of Antisemitism in South Africa, University of Virginia Press, 1994.
14Milton Shain, A Perfect Storm. Antisemitism in South Africa (1930-1948), Johnathan Ball, 2015.
15Sur ce point, lire également Tiffany Willoughby-Herard, Waste of a White Skin.The Carnegie Corporation and the Racial Logic of White Vulnerability, University of California Press, 2015.
16Christopher Marx, Oxwagon Sentinel : Radical Afrikaner Nationalism and the History of the Ossewabrandwag, University of South Africa Press, 2008.
17Gerald Horne, White Supremacy Confronted : U.S. Imperialism and Anti-Communism vs. the Liberation of Southern Africa from Rhodes to Mandela, International Publishers, 2019.
18Alan Wieder, Ruth First and Joe Slovo in the War Against Apartheid, Monthly Review Press, 2013.
